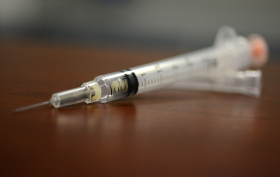Par Cesar Santos
Ce n’est pas par hasard que la démarche de construction d’opinion ou pensée critique est un des éléments du programme de formation de l’école québécoise. Sa pertinente est évidente dans des domaines très variés comme les soins infirmiers, l’administration, la psychologie, la formation politique et l’éducation.
Selon Bensley (2011)[i], la pensée critique est un des résultats les plus convoités dans le processus éducationnel, mais il constate qu’elle “remained poorly defined by many who use the term.” (P. 1) La conférence du professeur Jacques Boisvert nous a rappelé ce besoin de bien définir la pensée critique et nous a proposé des réflexions sur le « Quoi? » (caractéristiques, obstacles, conceptions), le « Pourquoi? » (utilité et avantages, doit-on ? peut-on ?) et le « Comment? » (les approches) de la pensée critique.
De quoi parle-t-on?
Notons que la conceptualisation de ce que l’on nomme la « pensée critique » est encore en construction et il y a plusieurs aspects qui doivent être clarifiés (Bensley, 2011), comme 1) l’utilisation non uniforme des termes en lien avec la pensée critique, 2) la question des dispositions, habilités et attitudes nécessaires à la pensée critique et 3) le besoin d’identifier les conditions ou les antécédents qui conduisent à la pensée critique, ainsi que les principes pouvant la rendre plus accessible. On pourrait ajouter la question de la transférabilité des compétences de la pensée critique. Cependant, s’il y a encore beaucoup à faire, dans son exposée, le professeur Boisvert nous a dressé un portrait des assises construites dans les années 1980-1995.
Par exemple, il a revu avec nous les définitions de la pensée critique de Richard W. Paul, Matthew Lipman ou celle de Robert H. Ennis[ii] : « Une pensée raisonnable et réflexive orientée vers une décision quant à ce qu’il faut croire ou faire ». Plus récemment et à titre comparatif, Epstein (2016)[iii] affirme que “Critical thinking is a set of skills that anyone can master. People who master these skills can see the consequences of what they and others say, they can formulate and communicate good arguments, and they can better make decisions.” Ce sont deux définitions d’orientation clairement pragmatiste, mais c’est à vous de juger si elles sont assez complètes.
Les rêves et la réalité
En se questionnant sur cette vaste production des années 1980-1995, notre conférencier nous proposait une réflexion sur les ambitions de ces années, sur les grands projets qui visaient à former des étudiants capables de fonctionner adéquatement dans une société complexe et de se protéger des manipulateurs. Par exemple, dans le but d’évaluer et après d’enseigner la pensée critique, plusieurs universités nord-américaines ont bâti des tests comme le Cornell Critical Thinking Test Series, qui prétendaient mesurer les niveaux de pensée critique chez les étudiants pour les former en conséquence. Presque trois décennies plus tard, il est temps de nous demander : étions-nous trop ambitieux ? Avons-nous avancé vers une éducation capable de former des gens critiques ? Si la réponse est négative, pourquoi n’y sommes-nous pas encore arrivés?
Le défi de la formation
Si nous n’avons pas encore réussi cette éducation novatrice, un des obstacles majeurs est manifestement la formation des formateurs. Enseigner la pensée critique n’est pas facile, car cela demande de former les futurs enseignants autant à la maîtrise de leurs disciplines qu’à la pensée critique. Pas évident ! En plus, on sait très bien qu’il n’y a pas de méthode unique et que les enseignants de certains domaines, comme celui des sciences, ne se sentent pas toujours à l’aise avec les approches pour enseigner la pensée critique. Ces approches impliquent une attitude dialogique, des questions ouvertes et la frustration de ne pas avoir des réponses définitives, sans compter le fait que cela implique une relation avec la classe qui laisse tomber, même que de manière temporaire, notre rôle « d’autorité » ou « d’expert ».
On devrait former les enseignants à l’utilisation de ces approches plus dialogiques et, de manière plus spécifique, aux différentes approches pour enseigner la pensée critique, par exemple les approches centrées sur les habilités, la résolution de problèmes, la logique, etc. Bensley (2011) regroupe les approches d’enseignement en cinq catégories : générale, immersion, mixte, infusion, infusion directe.
À ce sujet, Jacques Boisvert nous a parlé de l’infusion ou imprégnation, son choix méthodologique pour enseigner la pensée critique. Il s’agit d’enseigner de manière approfondie un sujet d’étude et d’expliciter les éléments de la pensée critique en jeu, les faisant ressortir pendant l’effort pour bien maîtriser le sujet.
Finalement, si on réussissait à former adéquatement, il nous resterait à déterminer dans quelle mesure les capacités et les attitudes apprises dans le contexte des cours ou des formations à la pensée critique sont transférables à des situations de la vie courante. « Sont-elles transférables à d’autres disciplines enseignées » dans le parcours scolaire? (Boisvert, 1997, p. 25)[iv]. Peut-on faire le transfert à d’autres sujets traités dans la même discipline?
Comme les données probantes s’accumulent d’un côté et de l’autre (fortifiant les positions de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas au transfert), selon Bensley (2011), le débat doit être repensé : la demande de choisir entre ceux deux positions est basée sur l’argument fallacieux de la fausse dichotomie. Au contraire, la pensée critique impliquerait, toujours selon Bensley, autant des habilités à caractère général que des habilités spécifiques à certains domaines.
Bref, entre notre rêve d’avoir des citoyens avec une pensée critique bien aiguisée et la réalité des résultats décevants, il faut redoubler d’efforts pour relever le défi d’une formation adéquate.
Cesar Santos est professeur de chimie au collégial. Dans le cadre de son doctorat en éducation à l’UQTR/UQAM, il est stagiaire à la Chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique.
Notes
[i] Bensley, A. (2011). Rules for Reasoning Revisited: Toward a Scientific Conception of Critical Thinking. Dans Critical Thinking, sous la direction de Horvath, C.P et Forte, J.M. Nova Science Publishers, Inc., N. York, 1-36.
[ii] Boisvert, J. (1999). La formation de la pensée critique : théorie et pratique, Saint-Laurent (Québec), Éditions du Renouveau Pédagogique Inc., (disponible au CDC, cote 723069).
[iii] Epstein, R. L. (2016). The Pocket Guide to Critical Thinking. Fifth Edition. Illustrations by Alex Raffi. Advanced Reasoning Forum -ARF. Socorro-USA.
[iv] : Boisvert, J. (1997). Pensée critique et enseignement : guide de formation en vue d’élaborer une stratégie d’enseignement axée sur le développement de la pensée critique. Regroupement des Collèges Performa. Québec.