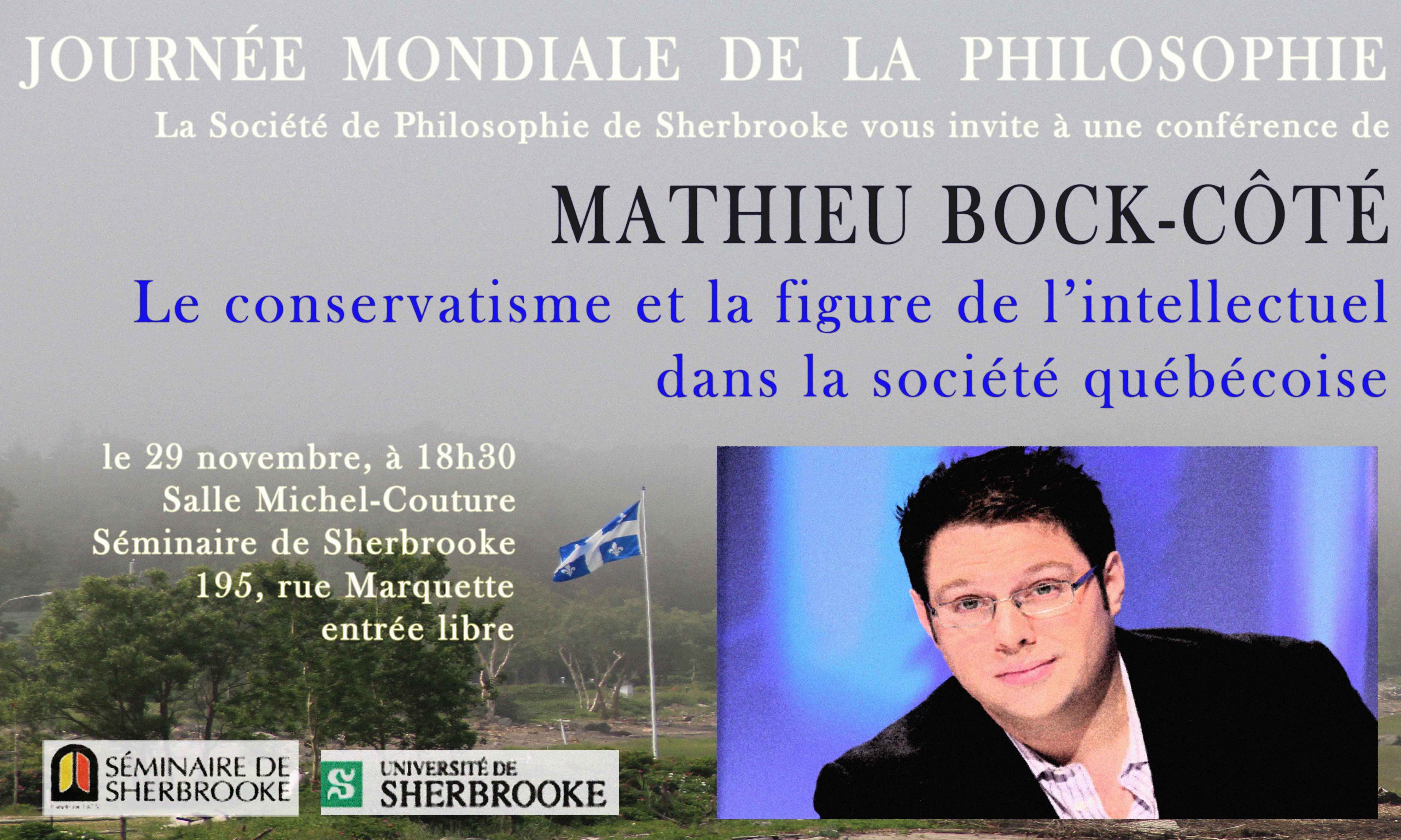Vous souvenez-vous de l’échec des négociations au mois de mai dernier? Autour de la table de négociations, le gouvernement et les étudiants s’étaient entendus pour le gel des frais de scolarité, tant et aussi longtemps qu’il serait possible de couper dans les budgets des universités; ensuite, il devait y avoir une augmentation progressive des frais, cohérente avec l’augmentation progressive des investissements publics dans le réseau universitaire. La base, c’est-à-dire les assemblées d’étudiantes et d’étudiants, dans un spectaculaire désaveu de la proposition, avait rejeté en bloc cet accord inouï. La situation était toujours plus difficile, la grève continuait, mais au moins, la lutte contre la hausse n’allait pas se retourner contre le fonctionnement des universités.
Au mois de mars dernier, donc bien avant que cette proposition ne soit avancée puis rejetée, nous avions suggéré entre autres choses, que les pourfendeurs de budgets universitaires risquaient de faire le jeu du gouvernement, qui rechigne à réinvestir depuis des lustres. Cette fois-là, nous avions évité la catastrophe grâce à l’entêtement de la base du mouvement étudiant. Mais cette fois-ci, il semble que nous allons avoir droit à une nouvelle période de stagnation. Car en effet, l’actuel ministre de l’éducation Duchesne vient de l’annoncer, aux 124 millions de coupures déjà demandées à l’automne, il va falloir en ajouter d’autres, au cours d’une période d’austérité qui devrait durer encore 16 mois. Cela veut dire milieu 2014 (2 ans pile après les élections de l’été dernier, à bon entendeur…).
Au printemps dernier nous jouions les Cassandre, en disant: “Maintenant que certains [le PQ] promettent d’annuler la hausse s’ils sont élus, nous avons passé un cap et le débat risque de s’enfoncer encore plus. Suite à la dévalorisation du milieu par les principaux intéressés, de loin, on gardera l’impression que les étudiants ne veulent pas payer pour une université mal gérée.” La “dévalorisation”, qui a pris de l’ampleur depuis un an, consiste à regrouper un faisceau d’arguments contre le salaire des recteurs, le contexte de compétition entre les universités, les publicités et les investissements en béton que cela demande. Pour les critiques de la gestion des universités, tout cela est dû aux décisions “arbitraires” et “injustifiées” des administrations universitaires, et en premier lieux des recteurs.
Soit dit en passant, je ne suis pas un fan de recteur, mais il ne faudrait pas non plus en faire les boucs émissaires d’une situation qui se joue à trois, avec les étudiants et le ministère. La situation de compétition et de surenchère d’innovations commerciales et publicitaires est indissociable du manque à gagner des universités; il faudrait dire haut et fort que la mauvaise gestion et une conséquence directe du mauvais financement, au sens où dans un contexte d’austérité, tout le monde est obligé de bricoler. Ça n’exonère personne, et les scandales restent des scandales, mais au moins la logique de la situation est préservée.
Mais comme on peut le constater aujourd’hui, l’argument de la mauvaise gestion universitaire fonctionne à plein, et le principe d’échanger mauvais financement contre gel des frais vient de devenir une réalité. Ce qui était d’actualité dans les propositions du printemps, pour sortir de la crise, revient de plein fouet aujourd’hui, mais dans un contexte de Sommet pratiquement à huis clos, où le ministre peut faire ce qu’il veut s’il ne déclenche pas de nouvelles grèves. Ayant concédé jusqu’à nouvel ordre le gel des frais aux étudiants, il a maintenant toute la latitude pour reprendre leur argumentaire de mauvaise gestion, et aller chercher dans les fonds des universités les sommes nécessaires à boucler un budget “assaini”.
C’est pour le moins une interprétation inattendue du slogan, “ensemble bloquons la hausse” par le ministre Duchesne, heureux de l’appliquer aussi à la hausse des investissements publics. Et un tel alignement FEUQ, FQPPU et du Ministère de l’éducation supérieure autour de la mauvaise gestion dépasse l’entendement. Les recteurs, et les autres professeurs qui ont peut-être cru aux promesses de réinvestissement, découvrent, sans doute avec amertume, une tactique qui consiste à promettre des investissements pour mieux demander des coupures. Et on constate que le ministre Duchesne ne change pas en mieux la formule. Les investissements seront au rendez-vous quand nous en serons au déficit zéro, ou dans ses mots: “On a une période à vivre de 16 mois pour arriver au déficit zéro. Par la suite, ce sera une autre logique”.
Aucun doute que plusieurs spécialistes de la logique seraient intéressés d’apprendre que la logique suit les cours de la bourse, mais pour l’instant nous refusons de rêver en couleur. Ce Sommet va se révéler impossible à franchir pour la CREPUQ. Les grandes universités québécoises, aux dettes déjà lourdes, vont continuer de plonger avec les coupures, et le réinvestissement, s’il vient un jour, ne servira qu’à combler les manques à gagner les plus urgents. Une telle situation s’est déjà produite en 2000, comme le déplorait alors la FQPPU. Il y avait une mince chance que le débat puisse être renouvelé par le Sommet, et atteindre une hauteur de vue qui aurait permis de comprendre la complexité de la situation et les changements à engager (les EEETP, par exemple), mais il est évident, aujourd’hui, que les mêmes démons hantent toujours la question de l’éducation supérieure au Québec.