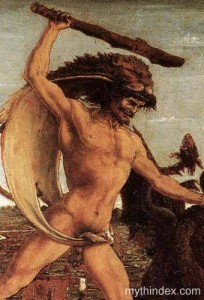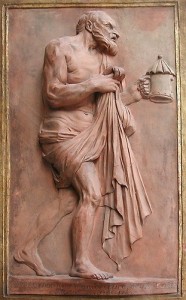Par Andréanne Veillette et Olivier Grenier
La propagation de fausses informations n’est pas un phénomène propre au monde contemporain. En effet, différentes formes de fausses informations circulent depuis toujours. Selon un article qui vise à définir le terme fake news, lorsqu’on emploie le terme « fausses nouvelles », on peut tout autant parler de satire, de parodie, de fabrication, de manipulation, de publicité que de propagande.
Le terme plus contemporain fake news renvoie à un problème précis qui a récemment pris de l’ampleur avec le Brexit (23 juin 2016) et l’élection de Donald Trump (8 novembre 2016). C’est un problème qui occupe une place immense dans l’espace médiatique. De plus, l’importance du problème transparaît dans l’usage que les politiciens font du terme « fake news » et des fausses nouvelles elles-mêmes. Les fake news sont rapidement devenus une arme dans une guerre politique.
Selon certains, l’ampleur actuelle du phénomène des fake news nous permet de déclarer le début d’une nouvelle ère : l’ère post-vérité. Cette nouvelle ère possède deux caractéristiques centrales. Il s’agit d’une ère durant laquelle le contenu médiatique est davantage axé sur les émotions que sur les faits objectifs et durant laquelle de nouvelles structures d’autorité se forment à l’extérieur des institutions qui produisent traditionnellement l’expertise.
Le principal problème vient du fait qu’une grande part du public croit aux fausses nouvelles. Les fausses nouvelles deviennent une alternative d’autant plus attrayante que le journalisme traditionnel souffre d’une importante crise de confiance :des sondages révèlent que le public ne sait plus vers qui se tourner pour obtenir de l’information fiable.
Dans ce qui suit, nous expliquerons deux façons complémentaires de comprendre l’essor du phénomène des fake news et nous suggérerons aussi quelques pistes de solution.
Une question de biais et d’éducation
La première façon d’appréhender le problème se fonde sur une compréhension du fonctionnement des biais cognitifs. Face à un aussi large volume d’articles, d’annonces et de tweets, il est commun, pour tous les humains, d’utiliser des stratégies de raisonnement pour simplifier le contenu à analyser. Cependant, ces stratégies mènent parfois à des erreurs systématiques : c’est ce qu’on appelle un biais cognitif. Pour plus de détails, voir le chapitre 13 (écrit par nos deux collègues Gilles et Jean-François!) de ce livre. Comprendre comment les biais cognitifs affectent notre rapport individuel aux fausses nouvelles est un premier pas pour combattre ce phénomène.
Évidemment, il est impossible, ici, de décrire tous les biais cognitifs qui affectent notre raisonnement dans le traitement des fausses nouvelles. Concentrons nos efforts sur deux d’entre eux : le biais de confirmation et l’effet Dunning-Kruger.
Le biais de confirmation est une tendance à préférer des informations qui s’accordent avec nos croyances, et à rejeter plus facilement celles qui ne s’y accordent pas. Par exemple, je crois être en bonne santé. Si un médecin m’annonce que j’ai un problème de santé, j’aurais davantage tendance à demander l’avis d’un second médecin que si le premier médecin m’avait annoncé que je suis en bonne santé.
Il est généralement raisonnable d’être prudent. Le problème, dans le cas du biais de confirmation, est que la prudence n’est pas partagée également selon l’information que nous recevons. Sur Internet, le biais de confirmation conduit à la polarisation des croyances des individus car ils rejoignent des communautés qui partagent leurs croyances. Ils ne sont alors plus confrontés à des avis contraires aux leurs.
L’effet Dunning-Kruger, quant à lui, est un excès de confiance. Les individus les moins qualifiés dans un domaine ont tendance à surestimer leur compétence dans ce domaine, tandis que les plus qualifiés ont tendance à les sous-estimer. Ce biais cognitif est problématique dans le cas des fausses nouvelles car les individus surestiment généralement leur capacité à reconnaître une fausse nouvelle (le baromètre de la confiance des Français dans les médias à ce sujet).
Que faire contre les biais cognitifs ?
Comment peut-on lutter contre les biais cognitifs et, incidemment, les fausses nouvelles ? Il faut d’abord prendre un pas de recul et reconnaître l’impact des biais cognitifs sur notre traitement de l’information. Il faut ensuite travailler, individuellement et collectivement, au développement de notre compétence à traiter l’information.
Le développement de la compétence informationnelle, selon plusieurs, est la responsabilité du système d’éducation. Cependant, selon Martine Mottet, de l’Université Laval, cette compétence ne serait présentement pas intégrée au Programme de formation de l’école québécoise, si ce n’est que quelques traces ici et là, par exemple dans la compétence transversale « Développer un sens critique à l’égard des technologies de l’information et de la communication ». Actuellement, la responsabilité revient donc à chaque enseignante et enseignant d’insérer l’éducation aux médias dans son cours de mathématique, de français, de sciences, plutôt qu’il n’y ait un cours qui y soit exclusivement consacré.
Or, de multiples recherches (voir notamment ici et ici) suggèrent qu’il y a des lacunes en recherche, en évaluation et en utilisation de l’information tant chez les élèves que chez les enseignants! Il existe des ressources en ligne, comme le site http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/, et des cadres théoriques, comme le Big6 Skills de Eisenberg et Berkowitz, qui sont utiles pour structurer un cours en éducation aux médias.
Une question de mépris et de pouvoir
Une deuxième façon de comprendre l’ampleur que prennent les fake news est liée au climat socio-politique actuel. Selon cette conception du problème, le principal moteur derrière l’adhésion massive aux fake news serait le résultat d’une profonde division sociétale.
Dans un article sur le populisme radical de droite, Cas Mudde expose une dynamique inquiétante qui existe dans les démocraties occidentales modernes. Une certaine portion de la population se percevrait comme les « perdants », ceux à qui les institutions traditionnelles ont causé plus de douleur que de bonheur. Ces gens se définissent ensuite par opposition aux « gagnants », ceux à qui le système actuel profite.
Il est important de comprendre que les gagnants et les perdants existent comme deux groupes totalement distincts et antagonistes. Selon la rhétorique qui accompagne souvent cette perception, le groupe des « perdants » est constitué d’honnêtes travailleurs, de « vraies personnes », alors que le groupe des « gagnants » est constitué de l’élite corrompue. Le mépris de l’élite que les travailleurs perçoivent, à tort ou à raison, cause énormément de colère et un désir de se défaire des institutions traditionnelles. Ce désir se manifeste notamment dans un rejet des médias traditionnels, de l’expertise académique et des politiciens qui font partie de l’establishment et par une ouverture aux sources d’information alternatives.
Les chiffres récoltés par le Pew Research Center montre une autre profonde division dans la vision des institutions traditionnelles, cette fois-ci au sein des partis politiques américains. Les sondages révèlent un dédain grandissant pour les institutions académiques et les médias traditionnels chez les républicains. Au contraire, les démocrates sont enclins à voir ces deux institutions comme des forces positives.
Outre les chiffres, les exemples qui démontrent l’existence d’une profonde division abondent. La rhétorique utilisée par Donald Trump exacerbe sans cesse la perception de l’élite comme un ennemi méprisant et joue sur la méfiance à l’égard des institutions où l’on trouve l’expertise traditionnelle. Par ailleurs, le discours de la prétendue élite alimente trop souvent cette perception. Un exemple particulièrement parlant est l’usage de l’expression « basket of deplorables » par Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle américaine pour faire référence aux partisans de Trump. Le lendemain, le hashtag « basket of deplorables » était l’un des plus populaires sur Twitter.
Face à ce mépris, les discours alternatifs qui rejettent les institutions traditionnelles contrôlées par les élites sont attrayants. L’adhésion aux fake news, qui est souvent accompagnée d’un rejet de l’expertise traditionnelle, pourrait donc être motivée par la colère plutôt que par l’ignorance. Si c’est effectivement le cas, tenter de résoudre le problème en « éduquant » une portion de la population qui se sent déjà méprisée par le système d’éducation et les experts traditionnels pourrait aggraver le problème.
Ainsi, un premier effort pourrait être de se tourner vers les institutions plutôt que les individus pour réduire l’exposition aux fausses nouvelles. Il serait naturel de penser qu’un effort médiatique concerté ou que la rédaction de nouvelles lois qui réduisent l’espace que peuvent occuper les fausses nouvelles pourraient être des façons plus efficaces de résoudre le problème des fake news. Toutefois, si le problème en est réellement un de mépris entre deux groupes sociaux différents, une véritable solution devra nécessairement passer par une réconciliation de ces deux groupes.
Des ressources contre les fausses nouvelles
On voit bien que les causes qui expliquent la popularité des fake news sont complexes. Attaquer ce problème exige donc de trouver des solutions qui tiennent compte de cette complexité. Il est tout à fait normal, comme individu, de se sentir désemparé face à cette situation. C’est pourquoi nous proposons, en guise de conclusion, des ressources utiles pour évaluer le contenu que vous consultez sur le Web.
Le détecteur de rumeurs de l’Agence Science Presse : http://www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-rumeurs
Un site français dédié à la vérification de la véracité des nouvelles : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
Un site Web d’information sur les fausses nouvelles : http://30secondes.org/
Des ressources pédagogiques sur la compétence informationnelle : https://habilomedias.ca/
Pour les technophiles qui veulent faire plus de recherche!
Pour trouver qui héberge un site Web : domaintools.com
Pour trouver qui partage un contenu : crowdtangle.com
Pour trouver qui a produit un contenu et les statistiques de participation : buzzsumo.com
Bonne navigation!