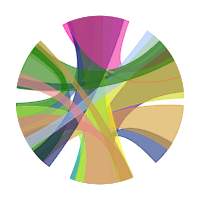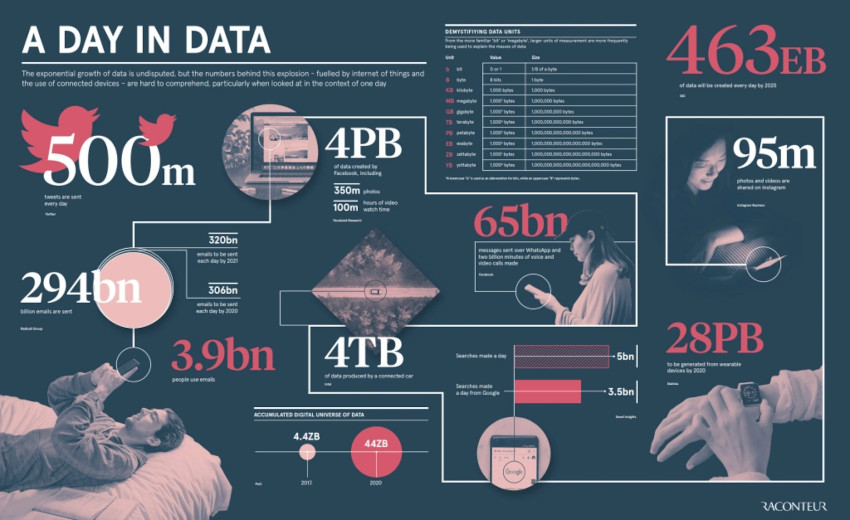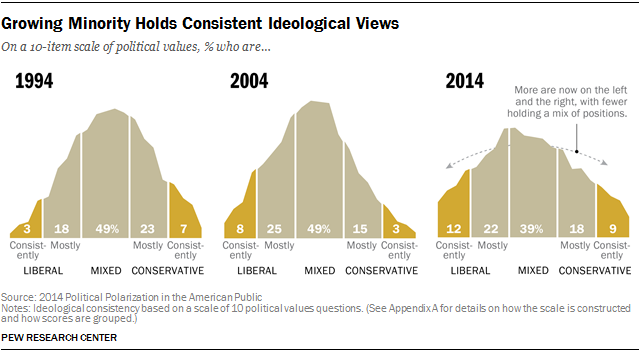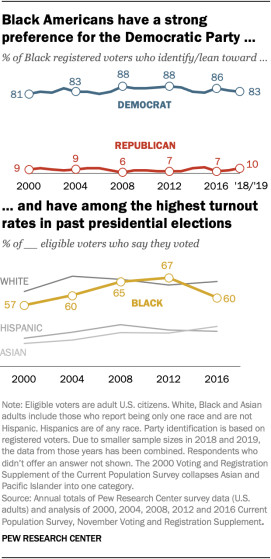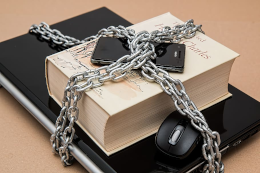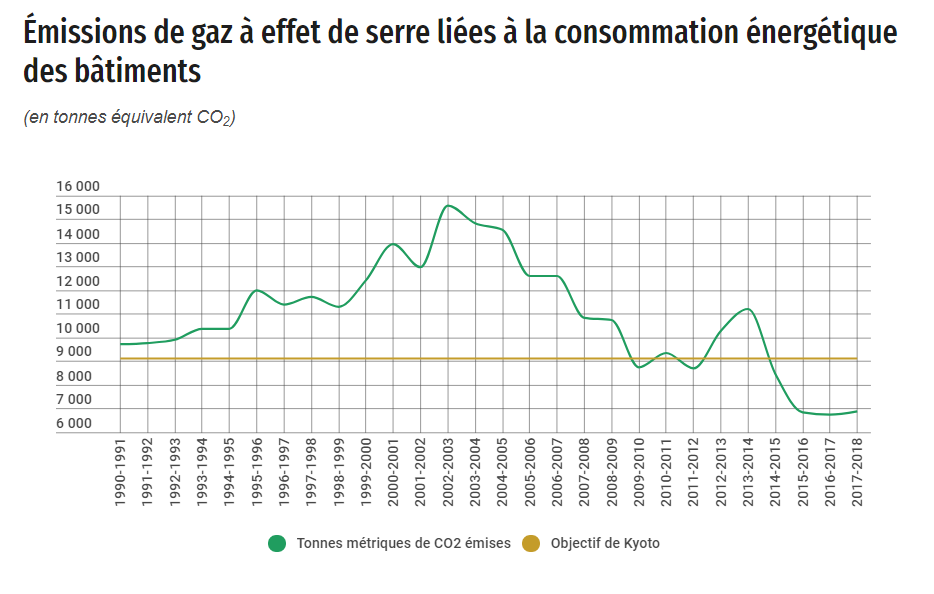Par Kevin Kaiser, doctorant à l’Université de Montréal
Mise en contexte
Le système des sciences subit présentement une forte pression pour le développement de l’interdisciplinarité en son sein. Par exemple, un nombre croissant d’initiatives (O’Rourke & Crowley, 2013), de curriculums universitaires (Jacobs & Frickel, 2009; Klein, 1990), de manuels (Repko et al., 2017; Repko & Szostak, 2017) et de programmes de financement (König & Gorman, 2017) sont créés explicitement pour promouvoir l’interdisciplinarité en science.
Ces appels à la prolifération des initiatives interdisciplinaires sont habituellement justifiés par diverses vertus que posséderait ce mode de production de connaissances. Par exemple, celui-ci serait
- plus apte à résoudre les problèmes sociaux et environnementaux (Bammer, 2017; De Grandis & Efstathiou, 2016; Hirsch Hadorn et al., 2008);
- produirait de la recherche de meilleure qualité (Ba et al., 2019; Chen et al., 2014, 2015; Kwon et al., 2017);
- favoriserait la création de nouvelles disciplines (Apostel, 1972; Klein, 2017);
- encouragerait l’innovation (Gerullis & Sauer, 2017; Gohar et al., 2019; Huutoniemi & Rafols, 2017; Pacheco et al., 2017).
Ce discours est largement repris par les organisations de même que les membres de la communauté académique et la société civile. Des mentions explicites peuvent aisément être trouvées en survolant
- la documentation des organismes subventionnaires (e.g. document de travail du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour appuyé sa consultation publique sur son plan stratégique 2030 nommée Appuyer la recherche multidisciplinaire et interdisciplinaire);
- les pages web de divers instituts de recherche (e.g. énoncés de mission du Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Science et la Technologie (CIRST));
- de même que les journaux (e.g. dans leur réponse des médecins de famille de l’Est-du-Québec suite à la parution d’une critique du modèle de gestion par Groupe de Médecine de Famille (GMF) par l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), ces derniers mentionnent que leur travail auraient plutôt dû être évalué, entre autres, sur leur contribution à l’interdisciplinarité).
Bien qu’il soit appréciable que la recherche interdisciplinaire profite d’une telle popularité, il reste que la faiblesse du discours critique sur celle-ci est inquiétante. En effet, il n’est pas rare d’être exposé à des discours sur l’interdisciplinarité et sur l’organisation générale des sciences qui sont au mieux mal informés, au pire carrément fallacieux.
L’objectif du présent article est justement de fournir quelques éléments pratiques de base pour permettre d’identifier certains de ces usages problématiques et, en précisant leur nature, de fournir les outils pour s’en prémunir.
État des lieux
Les discours erronés sur l’interdisciplinarité sont particulièrement problématiques en ce qu’ils rencontrent les trois caractéristiques suivantes:
1. L’interdisciplinarité est un concept mal défini
Entre multi-, pluri-, inter-, trans- et autres X-disciplinarités, la terminologie est très hétérogène et rarement précise. Ce faisant, les discours problématiques sont plus difficilement identifiables puisque le référent varie souvent.
– C’est vraiment beaucoup de choses que vous faites dire à un seul mot, fit observer Alice d’un ton pensif.
– Quand je fais beaucoup travailler un mot, comme cette fois-ci, déclara le Gros Coco, je le paie toujours beaucoup plus.
De l’autre côté du miroir, Lewis Carroll 2011 [1871], p. 77, éd. par Didier Hallépée
2. L’interdisciplinarité est un concept surutilisé
La profusion des initiatives, groupes de travail, instituts, programmes de formation et projet “interdisciplinaires” est moins le signe d’une interdisciplinarisation exponentielle des sciences (bien qu’une croissance soit observée à l’échelle des sciences (Larivière & Gingras, 2010; Porter & Rafols, 2009)) que de la surutilisation du terme.
3. L’interdisciplinarité est un concept ayant une influence sur les institutions scientifiques
Les organisations associées à l’entreprise scientifique ont rapidement adopté le discours positif sur l’interdisciplinarité. Bien qu’il semble que les initiatives de ce type aient encore quelques difficultés de financement (Bromham et al., 2016), les organismes de financement et universités travaillent activement au développement de ces initiatives. Si le concept possède une influence auprès des financements de la science et de ses lieux de production, alors son effet est indéniable sur les institutions elles-mêmes.
Prises individuellement, ces problématiques peuvent aisément être mitigées, par contre leur conjonction dans le cas de l’interdisciplinarité invitent à se pencher (rapidement) sur le problème. En effet, comme le phénomène d’intérêt est mal défini, que plusieurs initiatives sont identifiées comme tel de façon erronée et que les institutions fournissement de plus en plus de soutient pour celle-ci, les risques de ne pas obtenir les résultats escomptés sont élevés.
Usages problématiques et courants
Divers usages problématiques du concept d’interdisciplinarité peuvent être rapportés. L’idée ici n’est pas d’aspirer à l’exhaustivité, mais plutôt à décrire des usages communs que tout un chacun sont amenées à rencontrer dans leur pratique et de résumer en quoi ils peuvent être erronées.
L’usage négligent
- Description: Qualification laxiste et non rigoureuse d’une activité ou d’un produit comme “interdisciplinaire”.
- Problématique: La problématique ici concerne principalement la compréhension de la nature des interactions ayant eu lieu et du produit de celles-ci. Par exemple, en qualifiant d’interdisciplinaire une occurrence de multidisciplinarité, on met de l’avant de façon erronée qu’un processus de compréhension mutuelle et d’ajustement des croyances incompatibles a eu lieu, alors qu’ici, en réalité, divers spécialistes ont donné un avis sur un objet sans cet effort d’ajustement mutuel. De même, le produit n’est pas non plus un résultat intégrant ces différentes perspectives, mais bien éventails de points de vue. Cela ne veut pas dire que la multidisciplinarité ne présente pas d’intérêt (voir Mennes, 2020), seulement que le processus et le produit ne sont pas les mêmes.
L’usage comme valeur ajoutée
- Description: L’adjonction des termes multi-, pluri-, inter-, trans- et autres X-disciplinarités comme qualificatif d’une initiative, d’un événement, pour sous-entendre une valeur supplémentaire au projet.
- Problématique: L’usage de ces adjonctions sous-tendent que les différentes formes d’X-disciplinarités impliquent nécessairement des résultats, processus, et autres de meilleure qualités. Bien que les études sur la question laissent croire que cela puisse être généralement le cas en science, du moins lorsque l’interdisciplinarité n’est pas trop distale (voir Larivière & Gingras, 2010), le problème ici est que la clause nécessaire est évidemment fausse.
L’usage comme justification
- Description: Cet usage est l’un des plus problématiques. Il consiste à justifier une action (ou une série d’actions) par appel à la poursuite de l’interdisciplinarité.
- Problématique: La principale problématique avec cet usage est la confusion entre l’interdisciplinarité-comme-un-moyen et l’interdisciplinarité comme-une-fin. En effet, l’interdisciplinarité est un outil visant à résoudre un problème tenace ou urgent. L’interdisciplinarité en soi ne consiste pas en un objectif scientifique ou sociétal, il s’agit simplement d’une stratégie disponible ayant ses avantages et désavantages. L’idée ici n’est pas de dire que l’interdisciplinarité ne devrait pas être soutenu. Il s’agit plutôt de dire qu’elle ne permet pas de fournir un support justificationnel pour une initiative dans un argument de type moyen-fin
Petit lexique d’X-disciplinarité
Pour faciliter la reconnaissance des autres usages problématiques de même que les usages “appropriés”, quelques définitions sont utiles à garder en tête.
X-disciplinarités

Les principales formes d’X-disciplinarité peuvent être décrite suivant les définitions minimales suivantes 1:
- Multidisciplinarité: réfère à la juxtaposition de deux (ou plus) disciplines dans l’étude d’un problème pour lequel l’apport respectif est cumulatif ou additif et laisse celles-ci peu changées;
- Interdisciplinarité: réfère à l’intégration de deux (ou plus) disciplines dans l’étude d’un problème (parfois qualifié de complexe), pour lequel l’apport respectif est synthétique ou intégratif (résultant parfois en la création d’une nouvelle théorie ou discipline) et laisse celles-ci peu à moyennement changées 2;
- Transdisciplinarité: réfère à l’intégration d’une (ou plusieurs) discipline(s) et d’une considération externe à celle(s)-ci (parfois extra-académique, mais pas toujours) dans l’étude d’un problème, pour lequel l’apport respectif est synthétique ou critique et laisse celles-ci modérément à profondément changées 3.
Intégration
La notion d’intégration permet de distinguer multidisciplinarité et interdisciplinarité de même que les types d’interdisciplinarité. Plusieurs conceptions compétitrices existent pour cette notion. Celle proposée dans le manuel sur l’interdisciplinarité de Repko et Szostak présente l’intérêt d’être suffisamment générale est peu technique pour servir de définition minimale:
L’intégration est le processus cognitif d’évaluation critique des apports disciplinaires et de création d’un terrain d’entente [common ground] entre elles pour construire une compréhension plus exhaustive. La nouvelle compréhension est le produit ou le résultat de ce processus intégrateur.
Repko & Szostak, 2017, p. 65
Discipline
L’une des définitions les plus intéressantes pour sa simplicité et sa flexibilité est celle proposée par Bechtel (Bechtel, 1986; Kellert, 2006, 2008). Suivant celle-ci, une discipline est indentifiée et distinguée par:
- un domaine de recherche propre (e.g. biomolécules, comportement humain, etc.);
- un appareillage cognitif et ensemble d’outils particuliers cognitifs (e.g. concepts, méthodes, théories, etc.); et
- une structure sociale (e.g. revues spécialisées, départements, etc.)
Pour en savoir plus
- L’excellent manuel Interdisciplinary research: process and theory produit par Repko et Szostak (Repko & Szostak, 2017) est un incontournable. Il est le produit de plusieurs années de recherche, s’appuie sur un cadre théorique solide et présente un intérêt pratique majeur. Je suis personnellement en désaccord avec plusieurs éléments mis de l’avant (théorie de l’interdisciplinarité, modèle de l’intégration, modèle de ce qu’est un questionnement interdisciplinaire, méthodes proposées pour résoudre les incompatibilités), cependant il est difficile de trouver un ouvrage aussi complet.
- Pour les philosophes des sciences, le manifeste pour une philosophie de l’interdisciplinarité proposé par Mäki (Mäki, 2016) parvient en peu de pages à établir les grands questionnements et les éléments clés associés à cette sous-branche naissante de la philosophie des sciences.
- Pour les théoricien(ne)s des sciences, le Oxford Handbook of Interdisciplinarity (Frodeman, 2017) fournis un tour d’horizon intéressant de ce qui concerne l’étude de l’interdisciplinarité. Une alternative plus ancienne, mais toujours aussi pertinente est l’ouvrage clé de Julie Thompson Klein Interdisciplinarity : history, theory, and practice (Klein, 1990).
- Pour les praticien(ne)s cherchant un appareillage conceptuel efficace pour identifier et classifier les initiatives X-disciplinaires, la typologie proposée dans Huutoniemi et al. (2010) est à la fois simple d’utilisation tout en possédant une profondeur analytique intéressante.
1 Ces définitions minimales ont été produites en s’inspirant de plusieurs formulations (Holbrook, 2013; Huutoniemi et al., 2010; Kellert, 2008, pp. 1866–1867; Klein, 2017; O’Rourke et al., 2016, p. 24,29).
2 Bien que la notion d’“interdisciplinarité” est parfois utilisée au sens large, recouvrant multi-, inter- et transdisciplinarité, cet usage est a proscrire puisqu’elle consiste en un usage négligent du terme, alors que d’autres formulations sont apte à fournir la même généralité sans créer de confusion conceptuelle (e.g. les formes d’X-disciplinarité).
3 Il est à noter que la différence entre interdisciplinarité et transdisciplinarité est souvent exprimée en termes de degrés dus au rôle central joué par notion d’intégration dans l’identification de celle-ci (e.g. O’Rourke et al., 2016) recoupe toutes les deux sous l’appellation générale de “crossdisciplinarity”) et font parfois l’économie du terme de transdisciplinarité (e.g. Huutoniemi et al., 2010).
***
Travaux cités
Apostel, L. (1972). Interdisciplinarity Problems of Teaching and Research in Universities. Organization for Economic Cooperation and Development.
Ba, Z., Cao, Y., Mao, J., & Li, G. (2019). A hierarchical approach to analyzing knowledge integration between two fields—A case study on medical informatics and computer science. Scientometrics. https://doi.org/10.1007/s11192-019-03103-1
Bammer, G. (2017). Toward a New Discipline of Integration and Implementation Sciences. In R. Frodeman (Ed.), The Oxford Handbook of Interdisciplinarity (2nd ed., Vol. 1). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198733522.013.42
Bechtel, W. (1986). Integrating Scientific Disciplines. Springer Netherlands. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-9435-1
Bromham, L., Dinnage, R., & Hua, X. (2016). Interdisciplinary research has consistently lower funding success. Nature, 534(7609), 684–687. https://doi.org/10.1038/nature18315
Chen, S., Arsenault, C., & Larivière, V. (2015). Are top-cited papers more interdisciplinary? Journal of Informetrics, 9(4), 1034–1046. https://doi.org/10.1016/j.joi.2015.09.003
Chen, S., Gingras, Y., Arsenault, C., & Larivière, V. (2014). Interdisciplinarity patterns of highly-cited papers: A cross-disciplinary analysis: Interdisciplinarity Patterns of Highly-Cited Papers: A Cross-Disciplinary Analysis. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 51(1), 1–4. https://doi.org/10.1002/meet.2014.14505101108
De Grandis, G., & Efstathiou, S. (2016). Introduction—Grand Challenges and small steps. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 56, 39–47. https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2015.11.009
Frodeman, R. (2017). The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford University Press. http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780198733522.001.0001/oxfordhb-9780198733522
Gerullis, M. K., & Sauer, J. (2017). Interdisciplinarity of Innovation Assessments in Plant Breeding—A Citation Network Analysis (No. 1979-2017–3934). 1979-2017–3934, 3. https://doi.org/10.22004/ag.econ.262168
Gohar, F., Maschmeyer, P., Mfarrej, B., Lemaire, M., Wedderburn, L. R., Roncarolo, M. G., & van Royen-Kerkhof, A. (2019). Driving Medical Innovation Through Interdisciplinarity: Unique Opportunities and Challenges. Frontiers in Medicine, 6, 35. https://doi.org/10.3389/fmed.2019.00035
Hirsch Hadorn, G., Hoffmann-Riem, H., Biber-Klemm, S., Grossenbacher-Mansuy, W., Joye, D., Pohl, C., Wiesmann, U., & Zemp, E. (Eds.). (2008). Handbook of transdisciplinary research. Springer.
Holbrook, J. B. (2013). What is interdisciplinary communication? Reflections on the very idea of disciplinary integration. Synthese, 190(11), 1865–1879. https://doi.org/10.1007/s11229-012-0179-7
Huutoniemi, K., Klein, J. T., Bruun, H., & Hukkinen, J. (2010). Analyzing interdisciplinarity: Typology and indicators. Research Policy, 39(1), 79–88. https://doi.org/10.1016/j.respol.2009.09.011
Huutoniemi, K., & Rafols, I. (2017). Interdisciplinarity in Research Evaluation (R. Frodeman, Ed.; Vol. 1). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198733522.013.40
Jacobs, J. A., & Frickel, S. (2009). Interdisciplinarity: A Critical Assessment. Annual Review of Sociology, 35(1), 43–65. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-070308-115954
Kellert, S. H. (2006). Disciplinary Pluralism for Science Studies. In S. H. Kellert, H. E. Longino, & C. K. Waters (Eds.), Scientific pluralism (Vol. 19, p. 248). University of Minnesota Press.
Kellert, S. H. (2008). Borrowed knowledge: Chaos theory and the challenge of learning across disciplines. University of Chicago Press; /z-wcorg/.
Klein, J. T. (1990). Interdisciplinarity: History, theory, and practice. Wayne State University Press.
Klein, J. T. (2017). Typologies of Interdisciplinarity: The Boundary Work of Definition. In R. Frodeman (Ed.), The Oxford Handbook of Interdisciplinarity (2nd ed., Vol. 1). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198733522.013.3
König, T., & Gorman, M. E. (2017). The Challenge of Funding Interdisciplinary Research. In R. Frodeman (Ed.), The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford University Press.
Kwon, S., Solomon, G. E. A., Youtie, J., & Porter, A. L. (2017). A measure of knowledge flow between specific fields: Implications of interdisciplinarity for impact and funding. PLOS ONE, 12(10), e0185583. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185583
Larivière, V., & Gingras, Y. (2010). On the relationship between interdisciplinarity and scientific impact. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(1), 126–131. https://doi.org/10.1002/asi.21226
Mäki, U. (2016). Philosophy of interdisciplinarity. What? Why? How? European Journal for Philosophy of Science, 6(3), 327–342. https://doi.org/10.1007/s13194-016-0162-0
Mennes, J. (2020). Putting multidisciplinarity (back) on the map. European Journal for Philosophy of Science, 10(2), 18. https://doi.org/10.1007/s13194-020-00283-z
O’Rourke, M., Crowley, S., & Gonnerman, C. (2016). On the nature of cross-disciplinary integration: A philosophical framework. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 56, 62–70. https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2015.10.003
O’Rourke, M., & Crowley, S. J. (2013). Philosophical intervention and cross-disciplinary science: The story of the Toolbox Project. Synthese, 190(11), 1937–1954. https://doi.org/10.1007/s11229-012-0175-y
Pacheco, R. C., ManhÃes, M., & Maldonado, M. U. (2017). Innovation, interdisciplinarity and creative destruction. In R. Frodeman (Ed.), The Oxford Handbook of Interdisciplinarity (Vol. 1). Oxford University Press Oxford.
Porter, A. L., & Rafols, I. (2009). Is science becoming more interdisciplinary? Measuring and mapping six research fields over time. Scientometrics, 81(3), 719–745. https://doi.org/10.1007/s11192-008-2197-2
Repko, A. F., & Szostak, R. (2017). Interdisciplinary research: Process and theory (Third edition). Sage.
Repko, A. F., Szostak, R., & Buchberger, M. P. (2017). Introduction to Interdisciplinary Studies. SAGE Publications. https://books.google.ca/books?id=WyFuDQAAQBAJ