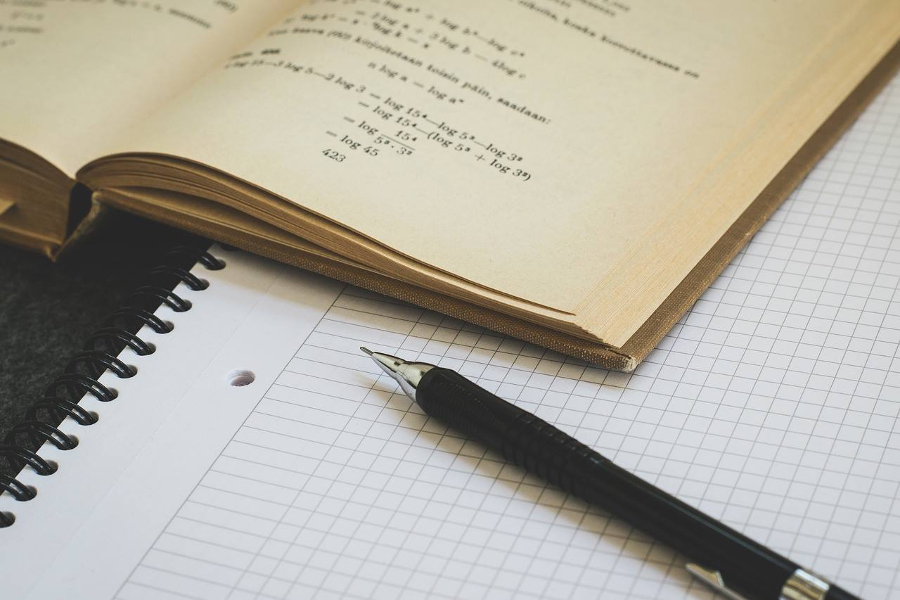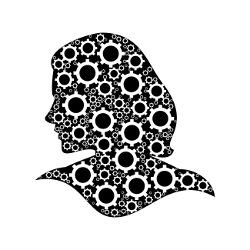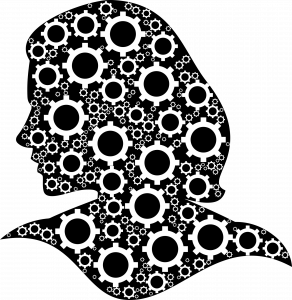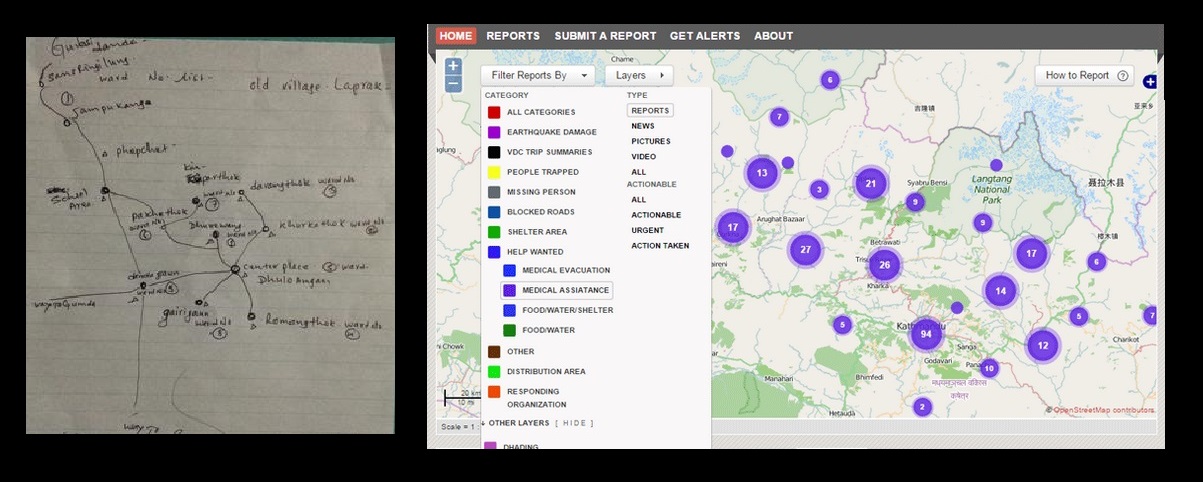Par Andréanne Veillette
Le 12 avril dernier, dans le cadre du cycle de conférences sur l’éducation citoyenne aux controverses sociotechniques organisé par la Chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique, la professeure Michelle Hoffman du Bard’s College dans l’État de New-York a donné une conférence intitulée « Comment apprendre sur l’apprentissage : la recherche sur le transfert de la formation et sa pertinence en éducation ». Les propos de Hoffman s’inscrivent dans une réflexion plus large en épistémologie sociale orientée vers les systèmes, notamment celle sur le système d’éducation primaire et secondaire.
Avant de s’intéresser à ce que l’épistémologie sociale orientée vers les systèmes peut nous apprendre sur l’éducation, il est nécessaire de définir brièvement cette branche peu connue de la philosophie. De façon générale, l’épistémologie est la branche de la philosophie qui s’intéresse à la connaissance et aux croyances. Alors que l’épistémologie classique se concentre sur l’individu, l’épistémologie sociale conçoit la production et la diffusion de connaissance comme une entreprise collective. Bien qu’il existe différents types d’épistémologie sociale, celui qui sera utile pour évaluer le système d’éducation et celui sur lequel je me concentrerai ici est l’épistémologie sociale orientée vers les systèmes. Comme son nom l’indique, il s’agit de l’épistémologie qui s’intéresse tout particulièrement aux systèmes épistémiques. Pour les fins de ce billet, un système épistémique peut être compris simplement comme une institution qui véhicule de la connaissance. Plus précisément, selon Goldman, l’épistémologie orientée vers les systèmes se distingue de l’épistémologie sociale des groupes principalement de par son objet d’étude. De fait, lorsqu’un épistémologue étudie un groupe, il s’intéresse aux croyances du groupe alors qu’un épistémologue qui s’intéresse à un système s’intéresse d’abord et avant tout aux objectifs du système. Autrement dit, l’épistémologie orientée vers les systèmes évalue l’organisation actuelle des pratiques d’un système donné pour déterminer si celle-ci mène véritablement à la production de connaissances fiables. (Pour en apprendre plus sur l’épistémologie sociale!)
Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, l’épistémologie sociale orientée vers les systèmes se concentre sur les buts du système d’éducation et à la manière dont celui-ci atteint ces buts. La première étape de notre réflexion devrait alors être de cerner les buts du système en question. Selon Goldman, le but du système d’éducation est la promotion de connaissances nouvelles, non pas pour la société, mais pour chaque apprenant individuel. Pour atteindre cet objectif, le système d’éducation doit organiser la transmission de connaissances de façon à créer un environnement propice à encourager l’apprentissage, à faciliter l’apprentissage autonome et à orienter l’apprentissage vers la vérité. De plus, comme le corpus scolaire ne peut pas couvrir toute la connaissance existante dans le monde, l’école doit nécessairement faire des choix. Ces choix seront effectués en accordant une préférence aux connaissances qui se transfèrent d’une sphère d’apprentissage à une autre ainsi qu’à celles qui servent de fondement pour l’acquisition subséquente de connaissances. (Pour en savoir plus sur ce que Goldman pense de l’éducation!)
Cette manière de faire des choix dépend de la possibilité réelle du transfert de connaissances d’une sphère à l’autre. En ce sens, la question empirique entourant la « transférabilité » des apprentissages est excessivement importante dans l’organisation du système d’éducation. Or, l’étude historique qu’a fait Hoffman des résultats expérimentaux démontre que le transfert d’apprentissage ne va pas de soi. En effet, les recherches effectuées, surtout en psychologie expérimentale, ont démontré que les apprentissages sont difficilement transférables d’une matière à l’autre et, particulièrement, d’un contexte scolaire à la vie extrascolaire.
Cela étant dit, il est important de noter que la recherche sur le transfert est sujette à de nombreuses controverses. De fait, lors de la sortie des premières études, les psychologues ne sont pas parvenus à un consensus en ce qui avait trait aux méthodes qui avaient été utilisées et aux théories de l’apprentissage qui avaient été mobilisées dans la production des résultats finaux. Un des éléments expliquant cette situation était la nouveauté du champ de la la psychologie expérimentale. En effet, la psychologie expérimentale, dont sont issues la plupart des études sur le transfert, en était à ses débuts au vingtième siècle. Par conséquent, elle souffrait encore de problèmes liés à la méthodologie, à la standardisation et à l’interprétation théorique des résultats. Par ailleurs, il n’est pas immédiatement évident que les résultats obtenus dans les circonstances contrôlées et hautement artificielles d’un laboratoire s’appliquent parfaitement à l’environnement réel plutôt chaotique d’une classe. Les résultats pourraient tout aussi bien être trop pessimistes que trop optimistes. Par conséquent, le questionnement sur la pertinence des résultats expérimentaux et sur ce qu’ils peuvent nous apprendre sur l’apprentissage dans la réalité est parfaitement légitime.
Bref, du point de vue de l’épistémologie orientée vers les systèmes, ce type de résultats est profondément inquiétant. La « transférabilité » des apprentissages étant une notion fondamentale (et considérée acquise) dans l’organisation actuelle du système d’éducation, il est difficile de faire abstraction des problèmes soulevés par la psychologie expérimentale. S’il s’avère que le transfert est effectivement impossible, l’organisation actuelle du système d’éducation n’est pas (du tout) optimisée pour rencontrer ses buts. Dans tous les cas, il s’agit d’une question empirique que l’épistémologie sociale orientée vers les systèmes doit se réapproprier pour faire une évaluation réaliste du système d’éducation. Tant qu’un travail empirique (et rigoureux!) n’aura pas été entrepris par les chercheurs en épistémologie sociale orientée vers les systèmes, les prescriptions normatives qui portent sur des sujets connexes à la question du transfert ne seront d’aucune réelle utilité quand viendra le temps de repenser l’organisation du système et d’accomplir des changements concrets.
Tout cela étant dit, l’exemple des recherches sur le transfert montre bien que l’épistémologie sociale orientée vers les systèmes bénéfice d’une approche interdisciplinaire où les travaux empiriques s’allient à l’analyse philosophique d’un système.
Andréanne Veillette est étudiante au baccalauréat. Elle travaille à la Chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique où elle s’intéresse tout particulièrement à l’épistémologie sociale orientée vers les systèmes et aux think tanks.